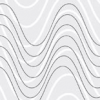![band-poesie]()
Suite à la première présentation de ce livre stimulant dans Libr-kaléidoscope 1/2, et tandis que l’auteur vous donne rendez-vous demain jeudi 13 mars à 19H30 (Textures Librairie, 94, avenue Jean Jaurès 75019 Paris), voici l’analyse fouillée de Typhaine Garnier. Bruno Fern, Reverbs phrases simples, éditions Nous, février 2014, 144 pages, 14 euros, ISBN : 978-2-913549-93-7. Comment faire trou dans l’ordure verbeuse sans tomber dans la pure dérision ? Bruno Fern est un poète qui sait se tenir à la règle qu’il s’est donnée.[1] D’ailleurs, il n’écrit le plus souvent que sous la contrainte. Dans reverbs, elle est affichée à l’entrée : « Ce livre est uniquement composé de phrases simples » (p. 7). Le poète se coupe ici les ailes, mais la contrainte est inventive : autour de et contre cette automutilation exhibée se trament de multiples complexités (sémantiques, thématiques, rythmiques). Leurs lignes de force, brisées, s’entremêlent. Quel est donc cet objet ? Ce pourrait être la question centrale de ce livre qui s’écrit et se décrit « en temps réel » (p. 11) ou presque (« Le décalage est la seconde mamelle », p. 34). L’écrit est sa propre représentation, c’est-à-dire qu’il croît au fil des définitions successives qu’il se donne : c’est l’homme-même.[2] Nulle prétention à l’exhaustivité, dans cette autoréflexion, ce ne sont que des éclats dispersés et disparates : « Certains considèrent ça comme un vrai bordel » (p. 59), « C’est une litanie de disjonctions » (p. 124), « Une série de lancers, voilà ce que c’est. » (p. 93). Parfois ce sont d’ailleurs plutôt des intentions que des définitions : « Le but est de donner de l’amplitude et pas qu’au son » (p. 93). Au vertige du rien (à raconter, à déclarer) répond la sensation de toucher la langue, dans une sorte de délectation qui rappelle la « langue poétique » de Christophe Tarkos[3] : « Une recherche de fluidité la phrase est malléable, poreuse et pas qu’aux extrémités en dépit des résistances » (p. 126). Par ce retour sur soi, le discours échappe à la fatalité du flux verbal : il résiste à la disparition instantanée des phrases lues. Des « remarques » pince-sans-rire viennent commenter ce qui précède[4], le lecteur est invité à reculer (« Cet adjectif devrait faire reculer de 8 phrases », p. 27), la lecture patine. « Mine de rien », Bruno Fern repose ici les questions essentielles qui travaillent la (ou du moins une certaine) modernité poétique : forme / informe, continu / discontinu, prose / vers[5], phrase / phrasé[6] . Parmi les questions récurrentes, celle de l’implication de « l’auteur »[7]. Evidé, « pas évident »[8], le « je » emprunte les mots d’un autre (Corbière) pour récuser le régime lyrique centralisé : « Je parle sous moi. / Ou à côté c’est une variante reliée souterrainement au phénomène à la petite cuillère multipliant les évasions »[9] (p. 78). Car en réalité, ce centre est partout, et non simplement dans les quelques tracés biographiques repérables : « [il] y est même sans y être apparemment toujours. / Avec un air de ne pas y toucher le masque. / Le contient dans chacune de ses fibres » (p. 21). À la fin, « la question du qui »[10] reste ouverte. De celui qui parle, on saura seulement qu’il est « définitivement inadapté à la situation » (p. 135). Pour autant, reverbs n’est pas un livre imperméable, clos sur lui-même. Loin d’être sourd aux choses du monde qui, « pendant ce temps », suivent leur cours immonde, il en organise la réverbération[11]. Sans rupture formelle, le propos métapoétique ne cesse de dériver vers le terrain de la « réalité ». On y trouve des lambeaux de scènes, on y rencontre de l’humain : angoisse existentielle (« Le tout est d’échapper. / À quoi est la question. », p. 18), « tragédie ordinaire » du rapport impossible (« Nos rapports sont parfaitement dissymétriques », p. 42), joies et scandales quotidiens. Mais c’est toujours avec humour et auto-ironie que le poète considère le « drame de la vie » : « Un matin, on peut tomber sur un os. / S’il est long, le percer pour en faire une flûte. / On en tirera donc tout de même quelque chose. » (p. 128). Comme chacun, il parle la bouche pleine des maux de l’époque : celle d’un individualisme décomplexé, où le « sujet capitaliste tardif » est principalement soucieux « d’aménager son intérieur au moindre coût » (p. 61) en profitant des « promos d’enfer » (p. 111), celle des prothèses médicalisées pour tous[12] et du « nettoyage » généralisé des corps, âmes, territoires et lexiques. Bruno Fern est de ceux pour qui l’origine de l’opération poétique se situe dans le dégoût de cette langue à « zéro déchet » qui nous cerne sans parvenir à nous faire avaler sa fable idyllique. Il s’agit donc toujours de « parler contre les paroles »[13] : « Les contraintes s’exercent sur les paroles. / Celle-là ou une autre ça chamboule tout » (p. 125-126). Si le poète ne dispose que de cette langue impersonnelle, pétrie de bêtise et raidie d’automatismes, il a aussi le pouvoir de la soumettre à sa loi. Celle de reverbs est parfaitement ironique puisqu’elle est issue du discours même contre lequel elle se retourne. En manipulateur distant et caustique, Bruno Fern scande et « roul[e] dans la farine » la prose des médias. Il détisse et retisse[14] autrement le réseau des expressions consacrées, plaçant le lecteur face à ses automatismes.[15] On a ainsi affaire – c’est la particularité saisissante du cut-up – à une langue impersonnelle dans ses éléments et personnelle dans son mouvement, dans son enchaînement singulier de gambades « hors de la grammaire ». La ponctuation devient une affaire de respiration : syntaxiquement, elle « compte pour des prunes » (p. 24), « la ligne continue se prolonge » au-delà du point (p. 56). La disjonction phrase / syntaxe produit ainsi d’heureux événements sémantiques[16] : « L’origine des mots est loin. / D’être indifférente […]. » (p. 15). Ici, la contrainte engendre donc véritablement un style, qui est un acte d’insoumission au monde communiquant dans son idiome impeccable. D’où l’insistance tout au long du livre sur la nécessité du « ratage »[17]. Ce monologue haché, difficultueux, au phrasé elliptique et heurté, progresse par « succession de déséquilibres compensés » (p. 18), de maladresses et d’à-peu-près[18]. C’est bien sûr une gaucherie calculée, une programmation de vices plus ou moins cachés[19]. La forme ne cède pas devant l’informe : elle le contient. Plutôt que de...
The post [Chronique] La contrainte faite style (à propos de Bruno Fern, Reverbs), par Typhaine Garnier appeared first on Libr-critique.