Image may be NSFW.
Clik here to view.
Stanislas Rodanski, Je suis parfois cet homme, poésie, Gallimard, octobre 2013, 176 pages, 17 euros, ISBN : 978-2-07-014347-4. « Puis il s’en alla tranquillement dans l’ombre, et devint une ombre lui-même » R. Chandler, La Dame du lac, fin du ch. XI (trad. Boris et Michèle Vian, 1949). Je poursuis ici le compte-rendu, entamé lors de ma précédente chronique sur Substance 13 (Des cendres, 2013), des publications inédites de Stanislas Rodanski procurées par François-René Simon à partir des manuscrits de l’écrivain déposés par son ami Jacques Veuillet à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Qui souhaiterait s’informer des éléments généraux du dossier Rodanski, tant sa biographie (1927-1981), désormais beaucoup mieux connue que voici dix ans, que l’histoire de ses écrits, de leurs éditions, et de leur interprétation, trouvera d’excellente provende sur le site de l’association Stanislas Rodanski. La plupart des commentaires de Je suis parfois cet homme que j’ai parcourus lisent ce recueil au miroir de la vie tourmentée qui fut celle de Rodanski, y compris dans sa relation au surréalisme dont il est le dernier soleil noir. Pour ma part, je voudrais surtout réfléchir à la façon dont son écriture travaille la langue et sur l’impact critique qui peut en résulter pour notre rapport aux clichés du discours dominant, ainsi décrits par Bernard Noël, « il n’y a plus aucune différence entre ce qui est représenté dans votre intériorité et la représentation extérieure que celle-ci devrait en projeter si l’emportement du flux ne l’empêchait de réfléchir. En somme, pas de marge pour la liberté de penser … » (A bas l’utile, Publie.net, 2010, p. 9). Pour nous décoller de ce prêt à imaginer poisseux, rien de tel que la lecture de Rodanski qui nous donne « rendez-vous avec l’inconnu ». À perte de langue « C’est avec une main de rêve que j’écris au tableau noir de ce temps opaque. » S. Rodanski, À perte de vue, dans Des proies aux chimères, Écrits, Bourgois (1999) p. 218. Afin d’entrer directement dans le vif du sujet, j’ai reporté en post-scriptum la présentation de la disposition formelle du recueil : titre, composition, répartition vers/prose, aspects métriques, etc. Ainsi commençons : comme l’explique F.-R. Simon dans son Avant-Propos, si beaucoup de ces poèmes procèdent de l’automatisme (les manuscrits sont peu raturés), ils relèvent en même temps (ou par là-même) de ce qu’on pourrait appeler la variation auto-plagiante ou l’auto-pillage qui met le lecteur en contact avec l’engendrement aléatoire des possibles qu’est le processus de l’écriture – avec tout ce qui afflue dans ce creuset ou cette baratte mentale des courants profonds de la langue ou de la mémoire littéraire. Une mémoire qui n’est pas celle du premier venu, car si Rodanski affirme, pince-sans-rire : « je ne dépends de personne sauf de Nerval qui lui-même s’est pendu », il a, comme tous ses congénères, beaucoup retenu, y compris (pour signaler jusqu’où cela va) tel sonnet de Jean de Sponde, cité dans son roman Requiem for me de façon exactement contemporaine à la redécouverte récente de ce poète « baroque » du XVIe siècle (Poésies, Genève, 1949). En outre, comme Desnos (L’Aumonyme, Rrose Sélavy, Langage cuit) ou Ernst (décalcomanies et frottages), Rodanski pratique à fins hallucinatoires un dérèglement méthodique de l’agencement des signes en vue de la signification : Les mots m’ont toujours mené loin dans la vie, trop loin pour que j’y renonce jamais car je les emploie désormais strictement dans le sens où ils m’échappent […] (Note liminaire du recueil). « On a retrouvé dans ses papiers, écrit F.-R. Simon, des listes de mots, de phrases, probablement destinés à des poèmes futurs. Il me reste des phrases dont il me fallait faire quelque chose, écrit-il encore à Jacques Hérold en accompagnement de son poème Bérénice » : un long poème courant sur huit pages (c’est le plus long du recueil). Enfin, il travaille la langue à la lettre en émule revendiqué de Raymond Roussel, c’est-à-dire en jouant son va-tout sur des permutations de lettres, de syllabes ou de morphèmes dont le caractère systématique apparaîtra aussitôt à quiconque consacrera un quart d’heure au parcours de ce recueil. Comme Le surétant non être est exemplaire à cet égard, en voici la première strophe : Naître. Mais nouveau-né, n’être pas. N’être rien. Mais mort-né, naître rien. Naissant en vain. Néant de n’être que né, fils de roi dont le père n’était pas prince, fils unique dont le père n’était pas au monde. N’était pas même lui seul. Le premier venu, c’est le dernier-né. Le premier-né, c’est le dernier venu. Je suis le dernier des morts et partout seul à l’instant que je suis. À perte de vue. Astu. Je suis allé au lieu d’avoir été. Au feu. Et en voici la troisième : Je tiens vaut un miens que deux tu l’auras Je tient d’eux. Nu. Tu l’auras de soi. J’aurai deux tu. Un miens c’est le tiens Nu que tu as vaut Astu que Statu quo. Un mien c’est d’eux que tu tiens deux siens. Un Un tiens c’est deux miens que le sien Nu Un point c’est tout ou rien Nu Un sein Nu Je ne vais pas assommer qui lit éventuellement cette chronique d’un décortiquage en règle des métagrammes, métathèses, anagrammes et autres jeux de permutations ici mis en œuvre ; je ferai simplement remarquer que Rodanski pratique en virtuose le jeu surréaliste des proverbes mis au goût du jour, avec les variations de cette strophe autour du proverbe : « Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » ; celui du collage (ou du montage) littéraire avec la concaténation de deux idiomatismes : « un point c’est tout » et « c’est tout ou rien » ; celui de l’anagramme : un/nu, Astu que/statu quo, ou de la permutation : sien/sein. La première strophe joue plutôt sur l’homonymie : naître/n’être ; le collage d’idiomatismes de sens contraire : le premier venu/le dernier né/le premier né/le dernier venu ; la parodie de la fameuse phrase d’Hamlet : naître/n’être pas (dont le battement équivoque dans le son et dans le sens – poursuivi tout au long du texte – rejette la fameuse alternative de l’être et...Clik here to view.
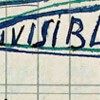
The post [Chronique] Au verso ardent de la langue : pour une poétique de Rodanski, par Jean-Nicolas Clamanges appeared first on Libr-critique.