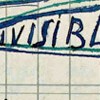![band-RodanskiSubst]()
Patrice Beray, Pour chorus seul, Éditions Les Hauts-Fonds, Brest, automne 2013, 70 pages, 14 €, ISBN : 978-2919171-02-6. _____________________________________________________________________________________________________ « Le sang monte quelquefois à la tête, lorsqu’on s’applique à tirer du néant une dernière comète, avec une nouvelle race d’esprits. » Lautréamont Dans cet élégant petit livre donné comme un « essai poétique » plus particulièrement dédié aux poètes Jean-Pierre Duprey et Claude Tarnaud, Patrice Beray présente une approche incisive des enjeux dramatiques partagés par la jeune génération surréaliste d’après-guerre, déchirée entre ce que Char appelle « un héritage sans testament » sur le plan de l’Histoire et la difficulté du mouvement surréaliste à accueillir durablement certains météores porteurs d’intensités comme celle-ci : « Notre nuit inhumaine nous a roulés ensemble jusqu’aux profondes profondeurs, et ce qui nous anime s’appelle la joie du gouffre » (Duprey, Derrière son double, rédaction en 1949). Jean-Pierre Duprey Dans ces parages où l’humour est un dieu noir, P. Beray a raison de souligner qu’on rencontre souvent chez Duprey « l’effroyable à lire », au sens de ce qui s’y reflète de la souffrance mentale endurée : « il ne fait pas de la poésie : il essaie de décrire ce qui se passe – ce qui est en train de se passer » (B. Noël) ; mais on peut regretter, à mon sens, que l’essai néglige ce que cet effet de « direct » bouleversant signe d’une poétique : Duprey cherche en effet à formuler une expérience pour laquelle aucune langue ne sera jamais prête, sauf à la forcer en recomposant, dans une sorte de désagrégation (re)créatrice, ce qu’elle a de plus intrinsèque : ses automatismes associatifs, ses locutions figées, ses clichés et ses stéréotypes, ses constructions basiques ; j’avais essayé, naguère, d’en esquisser l’approche ici. Mais pour autant, l’écriture n’est pas son seul mode d’expression : dans les longs intervalles où il s’en absente (deux tiers de son œuvre sont écrits dans l’année 1949, il n’y revient qu’en 1955-59, avant de disparaître), il se consacre à l’élaboration de sculptures de métal et de ciment toutes griffes dedans autour du vide (quatre reproductions photographiques en sont offertes) qu’il faut sans doute regarder comme la face de silence et de nuit de ces envers du corps qu’il hante mentalement : « C’est ici, disait une voix, c’est ici que j’apprends à défaire mon corps… J’ai déchiré mon corps, cette mâchoire autour d’un creux. Et mon geste, c’est l’espace cerné, le moule, en griffes radiées, réversible à l’image d’un gant de nuit cloutée… Et je préfère m’ouvrir les mains. » (« Les États-réunis du métal aux chutes communes du feu », in La Fin et la manière, rédaction en 1959). – Quant à ce qu’il lui fallut affronter d’épouvantable, lisez donc ce rêve : « C’est ainsi que je descends l’escalier d’une maison inconnue, un soir, sans tenir la rampe, car l’escalier est large et les marches faciles. Et puis tout de même, la rampe, la rampe est si lisse, d’un éclat si soyeux que je suis tenté d’y porter la main. Dès que je l’ai effleurée, je sens en contrepoint le toucher imperceptible d’une présence derrière moi. Avec un peu d’effroi, je continue à descendre et cela descend avec moi. Je me hâte et cela se hâte derrière moi. Je me retourne et vois une femme grande et mince qui me suit, sans faire le moindre bruit. Son vague sourire me rassure et je la regarde mieux pour être tout à fait délivré de mon épouvante. C’est alors que son sourire se déforme, tout en douceur vers plus de douceur et qu’elle semble descendre, toujours sans bruit, imperceptiblement plus vite, gagner sur moi, réduire la distance qui nous sépare. Son sourire, attentif à fixer mon regard se fige et c’est alors que je vois ses dents. Durant ces périodes, la sculpture est en sommeil. Je dois attendre, apprivoiser mon rêve, le rendre docile, me familiariser avec Cela qui veut éclater, jusqu’à la nuit où je rêve que je laisse Cela descendre jusqu’à moi malgré son sourire épouvantable, que Cela se fige et devient statue. Alors la statue me tend une pierre blanche, trop blanche, trop lisse et je sais que c’est la matrice du vide » (Extrait de Réincrudations, fin 1958-début 1959). Chorus par temps opaque : la décennie d’après-guerre C’est dans l’aventure de la revue NÉON (1948-1950) et celle des éditions du Soleil noir animées par François Di Dio, que se sont condensées et consumées les puissantes affinités électives qui ont attiré au surréalisme, avec le retour de Breton en France, les trois comètes qui font le sujet de l’essai, auxquelles se lie également, mais plus tard, la grande figure de Ghérasim Luca (Héros-Limite, 1953). C’est Rodanski qui trouve le nom de la revue : « N’être Rien Être tout Ouvrir l’être (Néant Oubli Être)… », quant à Duprey, il participera au dernier numéro en 1950, avec la « Lettre du sieur H qu’il envoya à lui-même », avant que Le Soleil noir ne publie l’édition originale de Derrière son double, tandis que Breton insère un extrait de La forêt sacrilège dans la seconde édition de l’Anthologie de l’humour noir, en présentant ainsi son auteur : « il ne dépend ni de lui ni de moi que dans la composition de l’humour noir, aujourd’hui par rapport à il y a dix ans, il faille forcer la dose du noir pur. Le génie de Duprey est de nous offrir de ce noir un spectre qui ne le cède pas en diversité au spectre solaire ». Au reste, l’opacité dont l’époque était porteuse infiltrait le groupe surréaliste lui-même : lorsque deux ans auparavant, les dissensions de Breton avec le peintre Matta provoquèrent l’exclusion de Tarnaud, Rodanski, Jouffroy et Alexandrian, en compagnie du peintre Victor Brauner, leur situation sera bien résumée par cette phrase de Rodanski : « sortis de là, nous nous trouvons libres – mais seuls éperdument ». S’éclaire ainsi le titre de l’essai, Pour chorus seul : rien moins que d’affronter en solo la liberté grande de l’expérience poétique entendue comme « réel absolu » (Novalis) où l’écriture double comme son...
The post [Libr-relecture] Chorus d’enfer : Duprey, Tarnaud, Rodanski, par Jean-Nicolas Clamanges appeared first on Libr-critique.